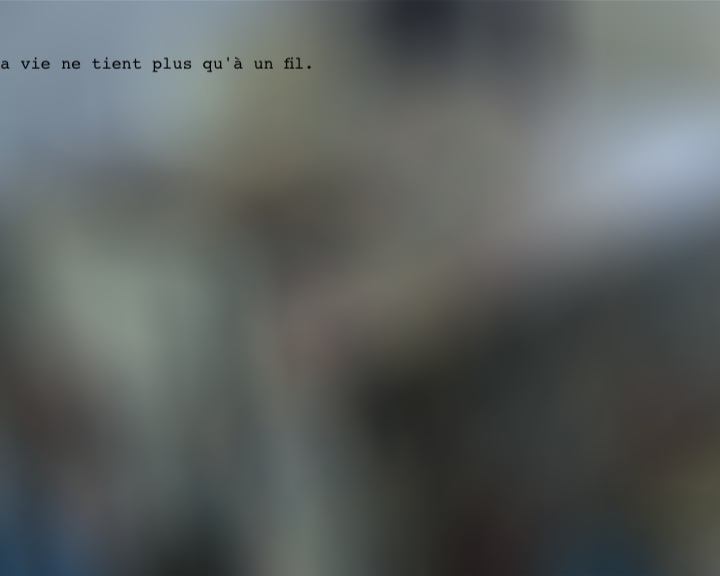Le sentiment d’urgence, qui peut se traduire en premier lieu par un mouvement qui ne parvient jamais à se fixer, est bien le motif qui semble lancer Tiger d’Orlan Roy. Ce film propose un geste cinématographique qui relève à plusieurs titres du transport : transport de l’existence, transport des sentiments, mais aussi transport des formes. Le film n’a de cesse de nous renvoyer à la possibilité du voyage, par de longs travellings dans un train de banlieue et des déambulations nocturnes en voiture, au cours desquelles les lumières de la ville (lampadaires, phares de voitures) concourent à l’amplification d’un climax posé par un fond sonore hypnotique et envahissant, une musique à la fois bruitiste et lancinante. La possibilité du voyage, c’est aussi ce qui noue le dialogue entre un homme et une jeune fille, qui dit son désir de partir en Australie. Pourquoi l’Australie ? Pourquoi pas l’Australie. Si le film d’Orlan Roy se donne dans une trajectoire à chaque instant recommencée, s’il se situe dans une sorte d’instabilité qui est expression de la vie elle même, laquelle ne saurait tenir en place sans se laisser gagner par ce qu’il y a de moribond en elle, c’est pour capter les éclats dont est capable notre environnement quotidien, éclats que nous pouvons voir si notre regard se pose sur notre entourage comme pour la première fois, et nos yeux se laissent dessiller par une lumière qui peut se lever au coeur des nuits les plus sombres et froides. Tiger semble toucher ici au fondement même du cinéma, et retrouver l’espace où il a pu commencer : capter cet enracinement poétique dans le réel qui tient et soutient notre existence, unifiée malgré son éclatement apparent et son mouvement insaisissable.
La cendre et la lumière de Jeremie Scheidler rejoint quelque chose de ces préoccupations. Ce film accompagne une jeune femme en partance pour le Liban. Les motifs de son voyage — s’agit-il d’un retour, d’une vacance ? — demeurent inexpliqués. Plusieurs scènes laissent percer toutefois le secret de cette (re)découverte de la ville. Il y a notamment ce passeport découpé aux ciseaux, ou encore ce téléphone portable qui n’est l’annonce d’aucune présence à venir. Une blessure enfouie semble s’immiscer dans le fil du récit, dont la forme se partage entre documentaire et fiction. Les déambulations dans la ville, le temps d’une cigarette fumée sur une terrasse au cœur de la nuit, une rencontre dans un café, la mise en scène laisse un sentiment de nostalgie émerger et gagner une vie qui va sur les chemins de l’intranquillité. Mais tout ceci ne laisse en rien présager le tremblement à venir. Car c’est le propre de toute explosion que de surgir de manière imprévisible, même lorsque des signes semblent indiquer sa possibilité, elle vient toujours déchirer notre espace intérieur de manière soudaine et définitive. Qu’il soit passionnel ou meurtrier, le feu qu’elle allume nous vient du dehors, et change radicalement, quand il ne la consume pas définitivement, notre vie. Jeremie Scheidler met en scène la radicalité de ce déchirement avec les moyens du cinéma et fait son film trembler des éclats d’une bombe au statut volontairement laissé indécis.
Avec la simplicité qui caractérise plusieurs de ses courts films récents, Marie Vermillard nous fait revenir d’un pays lointain. En reconduisant le cinéma à son geste le plus élémentaire, et, pour cette raison même, le plus essentiel — prendre une image, ici, maintenant — elle semble nous faire le récit du monde en abrégé. Son film se déploie en trois temps : une vue sur un arbre, comme une image d’un eden disparu, un vaste travelling fait depuis un train, à travers de grandes plaines, attentif à un jour qui vient, à moins qu’il ne se retire, et enfin des vues prises non loin de la gare du Nord à Paris, qui disent à leur manière un état du monde dans lequel nous vivons. Je vis sur TERRE est un chemin parcouru. C’est le même arbre dont s’émerveille le film en ouverture, qui peuple la vaste campagne traversée au rythme d’une musique kazakhe, et qui donne un visage aux parcs de la capitale. En retraçant ce chemin, qui est celui de la vie, de notre humanité elle-même, le film dit à la fois le matin de nos jours — et par là quelque chose de notre enfance — et le soir vers lequel nous allons quotidiennement.
Pour singulier qu’il soit, 26 de Daphné Hérétakis résonne fortement avec Je vis sur TERRE. Ce film cherche lui aussi, à sa manière, à se saisir d’un mouvement qui puisse embrasser conjointement la jeunesse de l’existence et son mouvement vers un terme inexorable. Dans ce film tourné en 16mm, qui repose sur un dispositif simple, des proches de la réalisatrice viennent lire face caméra des textes à caractère privé, reçus par elle alors que sa vingt-sixième année approchait. En se prêtant à l’exercice, les amis invités à lire un morceau d’intimité ne savaient pas que certains de leurs propres messages allaient rejoindre ce cadavre exquis, interprétés par d’autres. Tout cet ensemble, grave et léger à la fois, se formule dans le cadre très singulier du cimetière du Père Lachaise. Ces textes, les voix qui nous les donnent à entendre, les visages qui se livrent enfin à travers eux dressent le tableau d’une jeunesse qui ne se fait guère d’illusions sur le sens de l’existence et sur la vanité de certaines joies après lesquelles nous courrons. Mais peut-il en être autrement ? Certains dialogues de la Maman et la putain nous viennent à l’esprit. Si la proposition de cinéma est tout autre, le lieu depuis lequel parle ce film de Jean Eustache est également sillonné par ce bel ouvrage, qui tient du collage, de Daphné Hérétakis.
Dans ce parcours, le film de Marylène Negro franchit un pas au-delà. « Majeur et vacciné » est une formule que nous adressaient nos propres parents, quand nous entrions dans la jeunesse et qu’ils ne pouvaient approuver nos choix sans non plus les interdire. Le film va progressivement montrer comment cette expression peut se teinter de gravité et de sérieux, au fil d’un récit qui fait s’entrecroiser des souvenirs de jeunesse et l’évocation de moments difficiles où un proche est gagné par une maladie redoutable. Ce récit se dévoile par bribes, des phrases glissent sur des images imprécises, et sont par moments rompues, brisées par le surgissement d’images nettes et familières, qui nous viennent comme des fulgurances arrachées à une mémoire qui se tient en deçà de la représentation et dont le matériau exige quelque chose de nous pour être informé. Ce sont ces flous composés, qui font la plasticité remarquable de « Majeur et vacciné ». C’est aussi ce fond sonore, dans lequel des mélodies émergent régulièrement, autant de signaux qui participent de la mise en lumière de ce mouvement, plastique et littéraire ensemble, de retour sur une période douloureuse dans l’existence de Marylène Negro. Cette période s’éclaire de toute une vie qui l’a précédée, qui entre en dialogue avec elle, dans une situation de diachronie où la cinéaste doit dire à nouveau : j’ai dix ans. Avec la sensibilité et la retenue qui caractérisent son travail, Marylène Negro montre en quoi les moments de présence, qu’ils soient graves ou légers, peuvent se laisser traverser par les saillies de notre vie passée, qui leur donnent sens, et font de nous ce que nous sommes lorsque, malgré la difficulté d’exister, nous ouvrons les yeux, aujourd’hui, sur nos proches et sur le monde.
Àrvore da vida de Jacques Perconte vient, depuis un lieu atemporel, ressaisir le vif de ce cheminement cinématographique en ouvrant notre attention à ce qui l’excède de toute part : la générosité, la richesse des formes les plus simples qui se livrent à la caméra. Le film, qui se présente comme un cycle chromatique, voire monochromatique, va arracher la figure d’un arbre, filmé à Madère le printemps dernier, à un aplat de couleur, un vert au premier abord uniforme. Ce tableau est un arbre de vie au sens concret et immédiat. Ce qui va faire surgir ce plan enfoui d’un arbre, c’est le mouvement des branches, les siennes, et celle de toute la végétation environnante. Comme si cet arbre se découpait sur fond d’un arbre plus vaste encore, alors que l’image, dans le détail de chaque pixel, se teinte de milles nuances roses et bleutées. Àrvore da vida, c’est le vent qui agite sans discontinuer le contenu de l’image pour le faire apparaître, puis disparaître à nouveau dans ce même aplat vert initial. C’est alors la musique de Jean-Jacques Birgé, à l’orchestration précise, qui révèle la part narrative du film, dont l’apparente abstraction laisse entrevoir les pulsations invisibles qui sont au principe même du mouvement de la vie, lesquelles s’amplifient de chaque battement de notre propre cœur.
--
Ce texte a initialement été publié sur le blog de la recherche du Collège des Bernardins, suite à la programmation du Cycle Jeune création du 4 mars 2013. Les films étaient tous inédits, réalisés pour cette projection, qui entrait en résonnance avec l'expostion Arbre de vie qui se déployait dans les espaces du Collège des Bernardins.
Publié le 02/09/2014