ÊTRE LÀ - ÊTRE AVEC - ÊTRE SANS
Pour comprendre les travaux de Vincent Ciciliato, il importe d’avoir à l’esprit son double enracinement géographique, entre la Sicile où il a passé une partie de sa jeunesse et la Picardie où il a fait ses études. Pour exprimer synthétiquement les accents de sa pratique, on pourrait dire que sa boite noire est picarde et que son imaginaire est sicilien. Cette double appartenance se retrouve dans les espaces qu’il met en scène ou les références qui traversent son œuvre.
Après avoir fait une thèse en arts plastiques, Vincent Ciciliato séjourne deux années au Fresnoy, où il nourrit un fort intérêt pour les techniques et technologies contemporaines, sans déserter pour autant des pratiques plus classiques, comme le dessin ou la musique.
Un espace en attente
Gradiante est une pièce vidéo de 2005 qui contient les prémisses de plusieurs travaux futurs. Il s’agit de travailler sur le micro-mouvement en suivant un fil conducteur qui permette d’explorer simultanément ce qu’il induit visuellement mais du point de vue du son. Trois personnages approchent progressivement dans un cadre fixe, en faisant de rapides mouvements de saccades, selon un procédé que l’on peut voir à l’œuvre dans les films de Martin Arnold notamment. Mais ce qui caractérise Gradiante, c’est que ce travail sur ce mouvement à la fois progressif et empêché se double d’une recherche sur le découpage des espaces de l’image que les traitements informatiques permettent désormais. Il ne s’agit pas tant ici de déstructurer un plan, que de déployer une image à partir d’un jeu de déplacements contrariés. L’espace est ici en attente, c’est une potentialité. Les régions du cadre apparaissent progressivement, en fonction de la présence d’un corps qui s’y laisse travailler par un jeu subtil de répétitions et de différentiations.
En un sens, les trois gestuelles engagées dans le film sont synchronisées par les micro-variations, ce qui donne paradoxalement à leur déploiement une tournure ou une facture proprement chorégraphique. Ce corps dépossédé de sa mobilité propre répond à une rythmique machinique au moyen de laquelle il danse. C’est-à-dire qu’il active la matière musicale que ces micro-mouvements produisent, en même temps qu’il est agi par elle. Vincent Ciciliato a réalisé ce film en le travaillant par blocs, ce qui fait que chacun de ces trois corps est doué d’une rythmicité propre et dans le même temps s’inscrit dans un mouvement d’ensemble auquel il contribue. Ce jeu de la partie et du tout, du local et du global, dessine une partition sous jacente et conséquemment assoit la dimension chorégraphique du film qui est indissociable de la part phénoméno-machinique que le film cherche à faire surgir.

Confronté à une impossibilité, c’est moins le corps qui montre que la machine qui le reconduit à une dimension pathologique. Le son évoque précisément cette dépendance du geste à une mécanique, cette hyper-élécrification du corps compris comme une machine rythmique. A cet égard, il n’est pas anodin que les sons d’origine de ce film soient liés à des images interprétées par des logiciels de traitement sonore. C’est l’empreinte d’une texture charnelle qui nourrit l’espace musical du film et qui ordonne le corps de cette danseuse à une forme machinique.
Les travaux suivants de Vincent Ciciliato vont donner la pleine mesure de cet espace potentiel révélé par les corps qui le traversent ou les gestes qui y trahissent une difficulté à prendre place. En 2006, Maurice Benayoun propose, sous le titre The Art Collider, une interface de création P2P reposant sur des échanges de données (vidéos, sons, textes, etc.) dont l’ambition est de connecter des projets ou des lieux de diffusion. The Art Collider cherche ainsi à faire rentrer des projets artistiques exogènes dans des vases communiquant, à partir d’un système que les artistes peuvent activer comme il le souhaite en y introduisant leurs productions visuelles ou sonores. Vincent Ciciliato perçoit ce système comme un dispositif autoritaire auquel il répond en réalisant Qualia (2008-2010), une pièce générative qui puise à deux sources : le court métrage Tango de Zbig Rybczy?ski et le film Salo de Pasolini. Qualia emprunte au premier film une part de sa facture formelle et au second ses motifs. Les corps, qui obéissent au principe d’agrégation, du court métrage de Rybczy?ski, sont exposés à des variations par micro-mouvements, à la manière de ce qu’expérimente Gradiante. Mais cette fois-ci, comme dans les scènes les plus difficiles du film de Pasolini, ils sont pris dans des postures humiliantes et obscènes. Mais le comportement de ces personnages dépend du réseau informatique auquel ils sont ordonnés. Ce sont en quelques sortes des flux de données qui leur sont étrangers qui les animent. Ces corps exposés deviennent la parfaite image d’un sadisme technologique et l’expression immédiate d’un contrôle des corps, jusque et y compris dans les fluides qu’ils peuvent produire et qui deviennent eux-mêmes une sorte d’effectuation du système technologique : l’abjection, le dérangeant, la présence du regard à une scène qui devrait lui être cachée, loin de dérégler la machine, l’accomplissent. Cette boite vide ouvre sur un espace en attente, les corps y sont pris en main par quelque chose qui les orchestrent dans un ensemble où les individualités semblent occultées, effacées. Le système prend possession des corps dans leur nudité la plus extrême et les exhibe dans leur dimension organique.
Cette image-tableau synthétise les dispositifs de contrôle sur lesquels nos sociétés reposent très largement aujourd’hui et elle en manifeste toute la violence. Le résidu, les fluides, le biologique deviennent l’ultime point de résistance et d’achoppement aux systèmes de mise en visibilité qui saturent nos environnements d’existence. La mécanique est celle d’un corps qui a entièrement perdu possession de lui-même, et qui est sollicité pour matérialiser la face abjecte de l’autonomie des machines.

Des corps blessés
Le corps souffrant est travaillé par l’ensemble des mécanismes qui le dispose mais il continue de montrer qu’il a son propre volume, sa propre distinction du proche et du lointain. Par leur mise en boucle, les corps agrégés sont acculés à une forme d’autonomie qui ne peut pas leur être retirée. C’est aussi cette idée que découvre le diptyque Ordinary Compulsions (2012). Un premier écran se structure autour de la mise en scène de cinq allégories de compulsions particulièrement répandues, dans lesquelles chacun peut se reconnaître : se laver les mains, s’habiller, se gratter, etc. Ces gestes deviennent expressifs d’états psychologiques d’autant plus manifestes qu’ils dysfonctionnent. Un autre écran, synchronisé avec le premier montre un homme, filmé comme un personnage de fiction, avec ses traits et sa singularité, exposé à chacune de ces compulsions dans le rituel de sa préparation quotidienne. Les deux écrans se différencient donc d’abord par le degré d’incarnation des personnages qu’ils accueillent. Filmée sur fond vert, la séquence du premier écran obéit à une répétition des gestes par où s’élabore une nouvelle machine chorégraphique. Comme dans les pièces précédentes, c’est donc un espace en attente, ouvert à une potentialité qui tourne en boucle sur elle-même jusqu’à devenir pathologique et anxiogène que cette installation déploie. Cette pièce montre ainsi à sa manière que tout espace n’existe qu’à la mesure des mouvements que les corps qu’il accueille pourront y exécuter. Ce qu’il y a de nouveau dans cette pièce, par rapport aux précédents travaux de Vincent Ciciliato, c’est bien la présence, dans le second écran d’un corps qui a une singularité. Les figures du premier écran sont mises en corrélation avec le concret d’une expression individuelle du second cadre. Et la jointure se fait bien par cette singularité, traversée par chacun des débordements que les figures du premier écran épuisent à l’envi. Ce débordement est d’ailleurs pris en charge d’un point de vue figuratif par l’élément liquide qui traverse cette œuvre de part en part. L’eau glisse peu à peu d’un usage socialement déterminé – se laver les mains – à la manifestation d’une perte, d’un emportement, jusqu’à devenir peu à peu un fluide sanguin. Les gestes culturels et sociaux, dans leur répétition excessive, produisent l’effet inverse de celui que les conduites ordinaires cherchent à atteindre à travers eux. L’élément liquide intéresse Vincent Ciciliato car il permet de donner une organicité à quelque chose qui semble suinter des corps mais qui pourtant les dépasse et envahit la machine tout entière. Cette sève intérieure vient transpercer la récurrence du geste et dérouter le lit de son habitude.

La figure du corps blessé est également centrale dans l’installation interactive Tempo Scaduto (2012). Réalisée au Fresnoy, cette pièce repose sur l’idée, empruntée aux jeux vidéos, de time over, de temps écoulé. Pour développer cette œuvre, Vincent Ciciliato s’est inspiré de Letizia Battaglia et Franco Zecchin, deux reporters italiens qui ont passé une partie conséquente de leur carrière à documenter les crimes de la mafia sicilienne. Leur production photographique de l’époque consistait donc à venir capturer les traces – souvent des… corps dans des… flaques de sang – laissées par les crimes mafieux qui venaient scander les jours dans une ville comme Palerme. Dans ces images des deux journalistes, Vincent CIciliato pouvait reconnaître des rues ou des espaces où il venait jouer enfant. C’est cette connexion de l’âge adulte dans sa forme la plus violente et du monde de l’enfance que Tempo Scaduto cherche à nouer. Cette mise en relation n’a pas seulement décidé de la forme « jeu vidéo » que cette pièce à prise, mais aussi du type d’interaction avec le spectateur sur lequel elle repose. Le visiteur en effet, placé au centre d’une cible posée sur le sol, est invité à reproduire un geste que tout enfant à déjà réalisé pour imiter des images de violence : figurer un pistolet à l’aide de ses doigts et mimer une détonation avec un geste de la main, pour « exécuter » dans les photographies que présente l’écran l’une des silhouettes qui les traversent. La machine analyse le geste du spectateur pour animer un curseur sur l’écran. Si le tir vise une figure représentant une personnalité effectivement assassinée par la mafia, l’installation lance une courte séquence filmique qui vient documenter le crime en question. La cruauté et la normalité sont ici liées de manière indéfectible, comme elles peuvent l’être dans un quotidien où les pratiques mafieuses sont monnaies courantes. La scène de crime devient une scène de jeu et inversement. Le caractère enfantin du geste à produire pour devenir malgré soi, dans la découverte même de cette pièce, un élément déclencheur des représentations de crimes autour desquelles elle s’organise, produit souvent une résistance chez les spectateurs invité à activer l’œuvre. Le fait de ne pouvoir pas se dissimuler derrière un périphérique type « joystick » semble en effet abolir la distance du jeu et place chacun face à une situation qui peut se vivre comme un dilemme moral. La frontalité du geste requis pour lancer les séquences vidéos confronte le regard du spectateur à ce qu’il peut y avoir d’irréversible dans ce geste meurtrier qu’il s’agit de reproduire.

Images de la disparition
Tempo Scaduto pose ainsi la question de la disparition. Comment représenter un sujet qui fait défaut à la scène ? Cette question induit un travail différent des précédentes pièces : on quitte le territoire de la psychologie pour s’avancer sur celui de l’élaboration d’une absence exprimée par l’image. C’est ce que veut produire ce grincement entre un univers fortement ancré dans le réel et l’environnement ludique qui permet de l’explorer. C’est aussi cette figuration de l’absence que cherche à matérialiser la retouche des ciels dans les photographies prises par Vincent Ciciliato. Ces images sont avant tout des souvenirs qui marquent davantage par leur contenu narratif que par la tonalité de l’horizon dans lequel l’épisode qu’elles circonscrivent est restitué. Et il faut reconnaître en effet que les ciels n’ont pas de qualité particulière dans les souvenirs d’événements qui nous ont marqué.
Figurer l’absence, ou plutôt les effets visuels d’une absence, est aussi un acte central de Point of Interest (2016), pièce qui se donne à la fois comme un montage photographique et une vidéo. La question qui anime ce travail pourrait se formuler ainsi : que manifeste une intention engagée vers l’autre quand cet autre à disparu ? Quel déséquilibre se signale dans le rapport au monde quand notre présence à un environnement immédiat se tend et semble s’extérioriser en direction d’une absence ? Pour la version vidéo de cette pièce, Vincent Ciciliato est parti d’une photographie prise en bord de mer, sur laquelle des interactions entre plusieurs vacanciers sont sensibles. En effaçant, à l’aide d’un logiciel comme Photoshop, l’un des termes de cette interaction, la part expressive de l’image se trouve bouleversée de fond en comble. Les intentions des regards ou des gestes suspendus désertent leur évidence initiale pour exprimer un trouble, un déséquilibre, une carence à laquelle il ne manque pourtant rien. Dans cette vidéo, le bord de mer devient une matrice photographique, un bain révélateur qui accueille et révèle des présences qui deviennent excessives d’être confrontées à une lacune. Ce processus de révélation opère par soustraction de matière. Dans la vidéo en effet, les personnages en interaction disparaissent petit à petit, ce qui donne paradoxalement une densité particulière à la figure qui demeure insistante dans le mouvement du film.


C’est une tentative comparable que propose Brise, une vidéo réalisée à la même période. Cette fois ci, le trouble entre la présence et l’absence est prise en charge par un seul et unique personnage. D’abord perçue de dos, une silhouette féminine semble scruter quelque chose dans un paysage industriel. Contrairement à Point of Interest, le contexte n’est pas ici une surface d’apparition ou de révélation, c’est un élément qui coexiste avec l’attention de la jeune femme et qui lui répond en la polarisant. Le dynamisme de cette relation se matérialise plastiquement par le fait que la silhouette de la jeune femme est figée dans un décor quant à lui animé. Cette différence place cette personne dans une relation de vis-à-vis, sinon de séparation avec le contexte qui pourtant l’accueille et donne sens à sa posture. Mais cette tension ou attention suggérée va bientôt se dissoudre littéralement lorsqu’un changement d’axe manifestera que ce corps est celui d’une jeune femme sans visage. La disparition ici travaillée s’éprouve donc à même la présence de la figure, qui ne peut pas être présente à ce vers quoi elle se tourne.
Entre lumière et défaillance
Ces deux travaux explorent la question de l’intention, de l’intentionnalité, qu’ils cherchent à manifester en y introduisant des ruptures, des failles. Cette mise en évidence de ce que porte – ou cesse de porter – un regard engagé dans le monde va trouver de nouveaux développements dans Le Trouble d’Argos (2017-2018). Cette installation interactive met en relation deux modalités antithétiques de l’exercice de la vision. Une boite en bois fermée contient une petite scène organisée à la manière d’une crèche. Le spectateur est invité à découvrir en regardant par un trou ce que recèle cette boite, dans laquelle il ne voit d’abord rien. Plongé dans l’obscurité, le contenu de la boite se révèle progressivement, en fonction des mouvements d’yeux du visiteur. Un petit système technique de type « eye tracking » analyse la direction dans laquelle le regard se dirige et un faisceau lumineux vient éclairer la zone scrutée. C’est donc d’abord le regard du spectateur qui est sollicité et son attention apparaît dans ce dispositif comme une puissance de révélation. Quand le regard du visiteur tombe sur une petite figurine illustrant Argos, le géant aux cents yeux de la mythologie grecque, la tête de ce dernier s’anime en devenant le support d’une projection en « mapping ». Le trouble d’Argos veut donc mettre en relation deux qualités de regard, l’un lumineux, qui dévoile les objets sur lesquels il se pose, l’autre empêché par son extraversion ou sa démultiplication à l’excès.
Pour que le dispositif d’illumination s’enclenche, le regard du spectateur doit être aigu, presque insistant : le regard, en scrutant cette petite pièce intérieure, doit devenir un acte de préhension et de saisie, sentiment renforcé par l’environnement sonore de la pièce, qui est fait de sons de frottements et qui suggère une part de tactilité dans cet exercice de vision. Remarquons enfin qu’une version à venir de l’installation intégrera une figurine représentant Lucie de Syracuse, une sainte invoquée par les malvoyants et qui est associée, dans l’hagiographie chrétienne, à la lumière. L’iconographie religieuse la représente souvent portant une paire d’yeux sur un plateau.

Vincent Ciciliato poursuit ses recherches sur le visage dans sa dernière pièce, mais en les inscrivant dans une forme oraculaire. Discursive Immanence (2017-2018) est un portrait interactif qui montre les limites de l’idée d’une parole ou d’une pensée qui serait trans-individuelle, c’est-à-dire qui ne serait pas le fait d’une singularité mais portée et produite par une collectivité. Nos usages d’Internet ne cessent de nous confronter à cette possibilité à laquelle l’idéologie de l’intelligence artificielle donne une portée nouvelle et problématique. Discursive Immanence montre un buste qui se caractérise par la présence d’une main disloquée de ce corps d’appartenance et par un visage insaisissable qui s’anime sur un écran. Ce dernier est fait d’une foule de portraits photos qui s’interpénètrent les uns les autres. Le spectateur qui fait face à l’écran peut entrer en « dialogue » avec cette figure singulière, sans identité propre mais lieu de passage d’une multitude de traits hétérogènes. Il est invité à traduire sa pensée pour la rendre accessible à cette machine qui fonctionne selon les principes d’une intelligence artificielle simplifiée. L’analyse du lexique employé par le spectateur fait surgir des réponses qui n’en sont pas et qui invitent à poursuivre l’échange au moyen d’un éclaircissement supplémentaire. Le spectateur ne peut donc activer la machine et nourrir l’échange qu’en dévoilant peu à peu quelque chose de lui-même dont la machine ne peut rien faire.
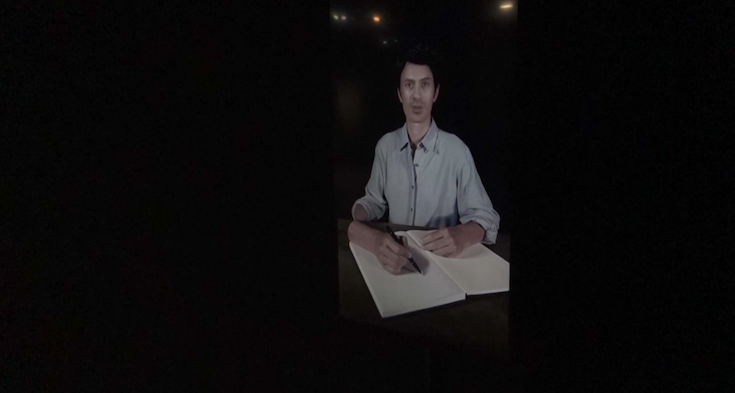
Ce résidu de singularité, ici apportée par le spectateur, est sans doute la part infime et précieuse qui traverse toute la production de Vincent Ciciliato. Dans cette œuvre en cours, la puissance des machines est confrontée à ses limites et ne révèle sa rigueur autoritaire qu’en nous éveillant également aux stratégies de contournement et de résistance que nous pouvons lui opposer.
--
Compte rendu de la séance du séminaire L'art tout contre la machine du 17 décembre 2018.
Publié le 10/01/2019





















