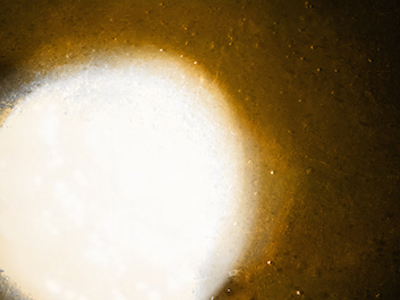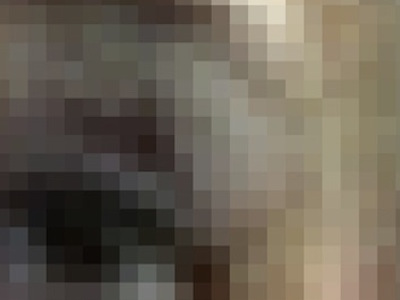Rodolphe OLCESE : J’introduis brièvement ce temps de rencontre en commençant par remercier La Colonie d’accueillir le Festival Côté Court pour ce moment d’échange. Nous avons souhaité provoquer cette rencontre autour d’une action de programmation inaugurée cette année. Le Festival Côté court a ouvert cette année une section compétitive consacrée aux « nouveaux médias ». Pour autant, nous nous sommes efforcés de construire une proposition éditoriale qui ait un intérêt intellectuel ou spirituel, avec pour idée de mobiliser une attention plus précise autour de projets que l’on voit passer, notamment à Côté Court, depuis quelques années, des projets qui sont extra-cinématographiques et qui de ce fait résistent à la salle de cinéma comme lieu de monstration, mais qui par ailleurs nourrissent ou renouvellent des gestes de cinéma. Nous voulions provoquer cette rencontre entre ces gestes-là et ces projets d’un nouvel ordre qui mobilisent des techniques innovantes tout en les contestant, en les critiquant ou en les détournant.
Cette question du détournement sera donc centrale dans nos échanges, et c’est à partir de ce thème que nous avons construit l’éditorial de cette programmation qui s’appelle « Effraction, dedans / dehors : à travers le miroir », titre que nous a suggéré Pascale Cassagnau.
Frank Smith, auteur qui vient de l’écriture, est là pour son projet Les Films du Monde, une série de ciné-tracts qui cherchent à interroger des collisions entre des textes et des images que l’on finit par ne plus voir à force de les faire circuler. Sébastien Betbeder, cinéaste issu des arts-contemporains, puisqu’il a fait ses études au Fresnoy, présentera Voyage à Kullorsuaq, projet d’accompagnent qui pose les conditions d’attente d’un film qui n’est pas encore là. Nicolas Maigret, pour The Pirate Cinema, propose un projet de capture et de collage à partir de flux vidéos interceptés dans des échanges pairs à pairs. Fred Perie, avec son film interactif L’autre de l’autre, implique les spectateurs immédiatement et concrètement dans l’expérience d’une projection de cinéma. Mathieu Pradat est l’auteur du film en réalité virtuelle Proxima, qui repose sur un motif narratif très ténu mais qui se construit sur un principe de collision et de passage d’un espace à un autre. Et enfin, Jean-Michel Bruyère a développé un projet de web-série générative qui s’appelle Tour Reservoir, mené au Havre et réalisé in situ, avec le désir de bâtir un imaginaire avec un groupe d’habitants d’une cité du Havre. Enfin, Valery Grancher est plasticien et travaille beaucoup sur les nouvelles technologies et l’utilisation des réseaux dans la mise en œuvre de formes héritées du monde contemporain.
Pascale CASSAGNAU : Lorsque l’on s’est réunis pour préparer cette programmation, on s’est dit qu’il s’agissait de se ressaisir de cette question des nouveaux médias de biais, voire de la contourner, comme si « nouveau média » était finalement un prétexte car peu intéressant en soi. Les œuvres le sont davantage et racontent d’autres choses, c’est pourquoi nous associons Lewis Caroll à cette sélection, afin de lier tout cela à la question du récit. Nous n’allons pas faire un historique des nouveaux médias parce que cette histoire commence à être vieille d’une vingtaine d’année. Les artistes se sont déjà copieusement emparés du sujet et d’une manière très riche, en composant une telle masse critique qu’elle serait impossible à ressaisir dans le cadre de cette rencontre – les œuvres, les expositions, les problématiques misent en jeu depuis les années 2000. En revanche, ce qui est intéressant pour nous ici, c’est de réinterroger chacun des artistes présents à l’aune des questions que posent leurs travaux. Il y a deux réflexions qui m’ont semblées évidentes en regardant le contenu de chaque projet proposés ici et dans la sélection : toutes les œuvres désignent la place du spectateur – se retournent et regardent ce spectateur – et interrogent la série, puisque chacun a pensé son travail dans une temporalité portée par un récit.

Jean-Michel BRUYERE : Je fais partie du collectif LKF’s qui s’est installé pendant deux ans dans un quartier du Havre, à l’invitation du Volcan, scène nationale. Ce quartier qui s’appelle Caucriauville est constitué de cités, de grands ensembles, qui comportent notamment la plus grande communauté Peule du Havre. Nous avons répondu à l’invitation du Volcan qui nous demandait de faire une création de spectacle en nous interrogeant sur les moyens de représenter les gens qui ne se rendaient jamais au Volcan. Nous nous sommes installés dans ce quartier et nous avons travaillé à essayer de représenter la féminisation des quartiers de grands ensembles avec une cinquantaine d’habitantes. Comment aujourd’hui ces quartiers, qui ont été construits et voulus par un pouvoir masculin, dessinés par des hommes, bâtis par des maçons hommes pour héberger des familles patriarcales dans des appartements qui modélisaient des petites usines de reproduction, sont-ils entièrement mis en route et continués par leur partie féminine ? Comment pouvait-on représenter ça ?
Nous avons essayé de voir quel était l’accès à l’image et à la représentation principale des habitants de ce quartier. Il s’est avéré que les seuls outils en usage, c’était le téléphone portable et la télévision, qui marche en permanence dans les appartements. Nous avons donc essayé de construire un projet qui s’adapte à ces deux supports.
La proposition de la série permettait de ne pas trop éloigner les gens au départ – si nous leur avions dit que nous allions faire du théâtre, ils seraient immédiatement partis. La web-série générative permettait d’être libre de faire quelque chose qui ne ressemblait pas à une web-série. Nous avons constitué ce projet ensemble, petit à petit, à partir d’un bâtiment qui s’appelle Tour Réservoir parce qu’il porte le réservoir d’eau du quartier sur la tête. Dans l’ancienne laverie collective, nous avons installé un studio de rencontres et un salon d’écriture pour toutes les femmes participant au projet. 2500 pages de texte ont été écrites, et sur ces 2500 pages, 1500 textes courts ont été extraits et enregistrés par un certain nombre d’entre elles. Cela a permis d’identifier beaucoup de lieux de tournage dans la ville. 75 000 clips vidéos ont été tournés, 1 500 prises de son ont eu lieu dans la ville, et nous avons créé les algorithmes nécessaires pour que tout cela existe en permanence et en temps réel sur un site internet, soit en pure-tv – où on ne fait que regarder et on laisse faire cette infinité (ou indéfinité) – soit par épisodes où l’on peut filtrer les contenus en choisissant une interprète, un sujet, une durée ou encore une langue. Le projet est en effet traduit en cinq langues, le russe, le peul, l’arabe, l’espagnol, l’ukrainien. Que l’on choisisse d’agir sur le contenu ou pas, il reste toujours génératif.
R.O : Merci pour cette présentation exhaustive. Comme cela a été dit, Tour Reservoir est un projet en ligne, je vous invite donc à le pratiquer.
Mathieu PRADAT : Proxima, c’est un court-métrage interactif en réalité virtuelle qui dure huit minutes trente, dont on verra la version linéaire à Côté Court, puisque nous développons encore les interactions. Dans ce film, un homme rencontre une entité lumineuse qui scintille et l’invite à la suivre. L’homme se met à sa suite à travers plusieurs espaces. La réalité virtuelle est étonnante parce que nous sommes physiquement téléportés dans un espace. Lorsqu’on met des lunettes de VR, on est dans un autre espace qui n’est pas virtuel, qui est totalement réel quand on le regarde et qu’on interagit avec lui. Gilles Deleuze dit quelque part que « le virtuel ne s’oppose pas au réel, mais seulement à l’actuel. Le virtuel possède une pleine réalité, en tant que virtuel ». Nous changeons donc de réalité dans un monde virtuel, nous entrons en collision avec le monde où nous sommes.
Quand j’ai commencé à travailler sur ce film, il y a un petit peu plus d’un an, je découvrais et — je continue de découvrir — ce média de la réalité virtuelle, d’abord par le documentaire puis maintenant par la fiction, et je le découvre en même temps que tout le monde, depuis 2014. Très rapidement, je me suis confronté à la question du point de vue en réalité virtuelle : quel est-il par rapport au cinéma ? Aujourd’hui, les films de réalité virtuelle proposent en général de se regarder d’un point de vue subjectif, tout le temps, à la manière d’un jeu-vidéo. Cette forme marche pour des formes narratives extrêmement « gamifiés » où on est sans arrêt en interaction à la manière d’un jeu-vidéo et donc moins concentré sur un récit. Cela a ses limites quand on est dans une forme narrative plus classique, et cela pose des problèmes évidents : si on incarne un personnage et qu’on ne le voit jamais, on peut faire un exercice formel de perception d’un homme invisible, mais on finit par ressentir un manque, une absence, qui empêche le dispositif de fonctionner complètement. Avec Proxima j’ai voulu m’essayer à la confrontation des points de vue : incarner celui d’une petite entité lumineuse qui nous permet de regarder un être humain et aussi d’être, à son tour cet être humain qui regarde cette petite étoile et qui la suit. Je voulais voir comment on pouvait raconter une histoire sur une opposition vraiment très simple, dans des lieux par ailleurs très variés. C’est peut-être une des manières dont ce film se rapporte au thème que vous avez identifié, l’effraction.
Fred PERIE : Le projet présenté à Côté Court est une coréalisation avec Franck Gourdien. L’autre de l’autre est un projet un peu à l’opposé de la réalité virtuelle puisqu’au lieu de nous transporter ailleurs, il nous astreint à être ici, dans la salle de cinéma. C’est un dispositif et un film qui exploitent la nature même du lieu de la salle de cinéma, un endroit qui, nous l’espérons, ne disparaîtra pas avec les formes nouvelles. Nous confrontons plusieurs choses dans ce film : la première chose que l’on voit en pénétrant dans la salle, c’est une caméra posée sur un trépied devant l’écran et qui vise la salle. En effet, pas de mystère, les spectateurs sont filmés. Le film commence comme ça, le dispositif lui permet de mélanger cette image en quasi temps-réel – il y a un léger décalage lié au système numérique de diffusion et une image enregistrée. Cette composition se fait selon un principe d’illusion : les personnes filmées font comme si elles étaient dans la salle de cinéma. Quand elles entrent dans la salle, c’est comme si elles entraient pour de vrai dans la salle. Elles prennent le temps de découvrir les lieux et puis elles parlent. Notre idée initiale était d’évoquer quelque chose qu’il est difficile de décrire puisqu’il n’y a guère que les neurobiologistes qui en parlent vraiment bien : lorsqu’on est en contact avec une autre personne, ou bien avec un film ou une pièce de théâtre par exemple, il y a quelque chose qui résonne en nous mais qui ne passe pas par le conscient, qui passe par des canaux directs que l’on peut appeler les canaux mécaniques primordiaux de l’empathie. Cette chose qui s’impose à nous mais qui n’est pas consciente entre en conflit avec ce que nous sommes. Nous avons donc demandé à des gens de nous parler de quelqu’un d’autre, d’une expérience personnelle. En cela, c’est un film documentaire. Les séquences enregistrées sont parfaitement respectées, nous avons essayé de couper au minimum, de ne pas intervenir sur la nature de l’image. Par contre, l’image connexe de la salle est retraitée en direct. Il y a parfois des effets qui viennent s’ajouter sur le public – que je ne révèlerai pas car il vaut mieux les expérimenter pour de vrai que de les voir en amont. C’est aussi un film classique, puisqu’il y a des séquences filmées, des images qui viennent d’ailleurs, qui sont comme dans un film classique et interrompent le fil des images. Quant au thème de l’effraction, c’est une question qui n’est pas simple. Le mot me fait penser à l'infraction qui est moins intentionnel que l'effraction. Pour moi, il fait pendant au mot « dispositif » puisque c’est finalement ce qui fait que socialement tout fonctionne, que l’on peut exister en tant qu’individu. Que ces dispositifs soient maintenant numériques ou rédigés sous formes de textes de lois dans le passé, tout cela suggère et appelle en permanence de notre part l’envie d’exister. Cette existence est forcément en effraction par rapport au code qui est promulgué par les techniques diverses, les techniques juridiques comprises.

Nicolas MAIGRET : Le projet retenu pour la sélection de Côté Court est The Pirate Cinema. C’est un travail qui a commencé en 2011-2012. La question de l’époque était liée à la génération à laquelle j’appartiens : il me semblait que cette génération avait un rapport très particulier aux questions de piratage, de copie, d’échange, d’appropriation, etc, et que sans doute il s’agissait de quelque chose d’assez spécifique à ce moment historique. A tel point que je pense que cela affecte aussi bien notre manière de nous cultiver, de travailler, notre accès à différents types de fichiers, et ce à différents niveaux dans la complexité de nos quotidiens. Cela me paraissait essentiel de trouver un moyen de développer un projet qui vienne se focaliser sur cette question. Un second niveau qui peut venir contextualiser ce projet, c’est que depuis le tout début de la vulgarisation du peer-to-peer, disons dans les années 2000, au moment où le processus est devenu très populaire, des compagnies ont œuvrées à collectionner des adresses IP – spécifiques à chacun des utilisateurs – pour monter des poursuites judiciaires pour le compte de tel ou tel ayant droits ou telle ou telle compagnies. Ils utilisaient tout simplement une des spécificités du protocole pair à pair : pour faire fonctionner de manière fluide ce protocole, il faut connaître l’adresse personnelle de chacune des personnes avec qui se mène cet échange. Donc, au cœur de ce processus, résidait la possibilité de le surveiller ou en tout cas d’être grandement conscient de ce qui s’y passe. Depuis à peu près 2004 et jusqu’à aujourd’hui, des compagnies travaillent pour les grands groupes et fournissent ces informations. D’un point de vue stratégique et tactique, il était intéressant de renverser cette même mécanique pour en révéler la vitalité, le dynamisme, le contenu des échanges, leur géographie, leur provenance et leur position. Sur le plan plus filmique, cela m’a semblé être une manière de réinvestir une réelle expérimentation sur la matière. Une matière peut-être moins filmique, comme cela avait pu être le cas dans l’histoire du cinéma expérimental, que vidéographique, avec des problématiques de compression, de fragmentation de fichiers, puisque les vidéos sont échangées par petites pièces d’une ou deux secondes, qui nous arrivent de manière complètement désordonnée depuis des pairs (d’autres utilisateurs aux quatre coins du monde) pour être ensuite ré-agencés. Cela donne une facture très particulière liées à la nature des échanges, à leur temporalité, leur répartition dans le temps : ce sont tous ces niveaux qui sont rendus visibles dans mon installation, en montrant les flux tels qu’ils sont consommés en temps réel.
Sébastien BETBEDER : Voyage à Kullorsuaq, c’est le nom du village le plus excentré du Groenland, au nord extrême. C’est un des derniers villages traditionnels de chasseur d’ours et de phoques. L’aventure de ce projet est née en 2014 alors que je venais de finir mon précédent long-métrage et que je n’avais pas l’intention de poursuivre immédiatement sur un autre projet de cinéma. Un matin, j’étais dans les locaux de la société de production qui accompagne mes films – Envie de tempête – et j’ai croisé le frère de mon producteur, qui s’appelle Nicolas Dubreuil (je l’évoque car il est à la base du projet qui nous réunit aujourd’hui) et qui est explorateur. Il vit là depuis maintenant vingt-ans, et il se trouve qu’il a trouvé un peu d’argent pour faire venir en France ses deux meilleurs amis chasseurs d’ours qui habitent ce village et ne l’avaient jamais quitté. Ole et Adam devaient arriver dans trois semaines suivantes et mon producteur me demande si cela m’intéresse de garder une trace de leur séjour en France. Evidemment, cette opportunité a rejoint à cette époque-là des préoccupations purement cinématographiques, touchant la question du réel et de la fiction et la préoccupation de fabriquer des films de fiction à partir de personnages qui « interprètent » leur propre rôle. J’ai donc accepté cette proposition. D’un point de vue matériel, je n’avais pas le temps de monter un dossier et de demander des financements. J’ai aussi eu très peu de temps pour écrire le scénario, mais je m’y suis attelé malgré tout, et là l’idée me vient que pour que ce film marche, il faut que je parte dans l’aventure avec deux comédiens. Je fais appel à un comédien avec lequel j’ai déjà travaillé, Thomas Blanchard, et à un deuxième que je connais d’une autre expérience, Thomas Scimeca : je leur demande de devenir les hôtes d’Ole et Adam et d’être la caution fiction de ce projet. Le film s’est fait. Il est devenu un court-métrage qui s’appelle Inupiluk, un mot inuit qui signifie « gangster », ou plus précisément « chenapans ». C’est d’ailleurs le nom que porte Ole et Adam dans le village où ils vivent. A la fin de ce film, qui dure 30mn, Ole et Adam proposent aux deux Thomas de faire le voyage inverse et de venir à Kullorsuaq. Je me dis alors qu’il y a un projet de cinéma encore plus fou à développer, en continuité de ce court métrage, et qui consisterait à répondre à cette invitation en allant faire un long-métrage dans ce village et dans les mêmes conditions de travail, avec cette même nécessité de confronter le réel et la fiction. Deux ans et demi après, avec mon producteur, nous avons réuni les fonds pour financer ce film qui s’appelle Le Voyage au Groenland. Lorsque l’idée a pris forme, nous nous sommes dit avec le distributeur du film et la société de production que nous allions vivre une expérience assez inédite, pour nous mais aussi de manière générale puisqu’aucun film de fiction n’avait été fait sur ce territoire, à l’exception de Nanouk l’esquimau de Flaherty. Je me pose alors la question de la diffusion d’un film au cinéma aujourd’hui et il me semble alors intéressant de la penser comme un processus expérimental et d’accompagner ce long-métrage de tout un pendant « transmédia » - pour le dire très vite, car j’ai moi aussi tout un problème de vocabulaire lié à cela. Je ne savais pas très bien ce que cette intuition voulait dire, mais je savais que j’avais deux personnes, Thomas et Thomas, qui étaient un peu mes doubles, et qui allaient vivre cette aventure dans le grand nord pendant cinq semaines. Qui plus est, ces deux personnages existaient déjà avec Inupiluk.
Se construit alors un processus qui se déploie selon plusieurs arborescences : d’abord, une web-série, qui s’appelle « Thomas et Thomas vont au Groenland », en dix épisodes, cinq qui racontent les préparatifs à Paris, et cinq épisodes tournés là-bas, en parallèle du tournage. Il y avait cette idée vraiment terrifiante et excitante à la fois de continuer à faire vivre des personnages sans déflorer le long-métrage, entité à part entière qui n’aurait pas besoin de la web-série pour exister. Il ne fallait donc pas spoiler l’aventure des Thomas là-bas avec cette web-série. Puis, il y avait un autre pan qui était un journal de bord, le pari étant que je tienne quotidiennement pendant cinq semaines de tournage ce journal qui racontait les journées de tournage du long-métrage. Ce journal vidéo se tournait dans le gîte dans lequel nous étions, mon équipe et moi. J’avais tous les soirs un invité qui venait face-caméra avec moi, qui pouvait être un des techniciens du film ou un des deux Thomas. C’était aussi un projet très intéressant où se mélangeait l’expérience du tournage et ces personnages, Thomas et Thomas, qui étaient à la fois comédiens de mon film et personnages de la fiction. Le troisième temps de ce projet était une partie purement documentaire, réalisée par un garçon qui nous accompagnait et qui s’appelle Hugo Jouxtel, à qui j’ai demandé d’aller voir certains villageois. Il avait une carte-blanche pour mener un travail documentaire qui pourrait être un à côté du film. Tous ces éléments-là étaient mis en ligne avec un décalage d’une semaine par rapport à ce qu’on vivait mais dans une idée de direct malgré tout puisque nous travaillions au Groenland : nous tournions, nous montions, et nous envoyions le contenu sur une plateforme internet encore consultable aujourd’hui. Il y avait donc aussi la volonté de regrouper une communauté, pour employer des mots « transmédia », qui aurait une première approche de ce qu’allait être le long-métrage de cinéma qui allait sortir un an plus tard. Le film est sorti le 21 novembre 2016, et à cette occasion nous avons réactivé ce projet qui était en sommeil depuis la fin du tournage, un mois avant la sortie du long métrage, en réinvestissant le processus qui consistait à activer les contenus cinq semaines avant et cinq semaines après.
Valery GRANCHER : Mon projet est un site internet que j’ai développé en début d’année et qui est une extension de mon studio. Le site présente des pages vidéos, des animations multimédias, de la réalité virtuelle, des choses produites à partir de ce qu’on appelle l’intelligence artificielle. Pour expliquer un peu ma position, je dirais que ce qui m’intéresse en tant que plasticien, c’est la question purement plastique des médias que j’utilise. Cela va d’internet à la peinture, avec les séries de Google Painting, à la réalité virtuelle et à tout ce qui touche post-média, post-internet, post-painting, etc. J’ai été amené à faire une première pièce en réalité virtuelle avec les nouvelles technologies de Google, et notamment le Google Tilt Brush qui permet de faire des peintures en 3D et en réalité virtuelle. Cette performance a été produite et je me suis donc équipé et lancé dans ce travail, qui relève de l’hybridation et s’inscrit dans mon questionnement de l’après peinture. On arrive à un moment dans les médias où on atteint des formes avec lesquelles il y a tout à écrire, tout à questionner, comme un recommencement, sur le regard que l’on porte mais aussi dans la pratique même de la peinture. Quand on utilise Google Tilt Brush, on fait des gestes dans l’espace enregistrés sous forme de pinceaux ou de textures. C’est un nouvel espace qui s’ouvre pour le regard qui se redéfinit et se renouvelle constamment, puisque selon les personnes qui entrent dedans, on n’aura jamais le même point de vue, la même déambulation, etc.

Frank SMITH : Je présente une série de ciné-tracts que j’ai regroupés sous le terme générique Les Films du Monde. Au départ, je m’inscris dans une démarche d’écriture poétique, le poétique étant pour moi un rapport de conscience aigu au monde, pour créer des effractions quant au langage dominant. A cela s’ajoute un rapport de crispation au langage doublé d’un intérêt particulier pour les transversalités dans le traitement de l’image, entre l’image visuelle, l’image sonore et l’image textuelle. A travers les ciné-tracts, tels qu’ils ont été inventés par Chris Marker et Jean Luc Godard en mai 68, j’essaie de remettre à plat cette forme pour repenser les liens qui peuvent exister entre ces différentes images, dans des effets d’effractions politiques, au sein des flux continus innombrables et permanents de ces images. A Côté Court je présente les dix-neuf premiers ciné-tracts, une série de courts films. Pascale faisait allusion dans son introduction à ce qui réunissait les œuvres de ce soir, le principe selon lequel nous sommes autant vus que voyants : cette dimension objectif / subjectif au cinéma m’intéresse beaucoup. L’objectif au cinéma, ou en tout cas au niveau de l’image vidéo, c’est ce qui donne à voir. Il est alors intéressant de traiter ces rapports, ces incidences autour d’opérations, de réflexions, entre les tensions sujets et objets : le spectateur étant vu par la caméra qui réfléchit. Je compte aller jusqu’à la production de 68 ciné-tracts en me fixant l’échéance de mai 2018 pour rendre hommage aux premiers cinés tracts réalisés en mai 1968. Il est alors pertinent de s’interroger sur la nature d’une série : on la traite trop souvent dans ses composantes temporelles, en faisant des séries d’épisodes qui se joignent. A l’inverse, je trouve stimulant de pratiquer des effractions dans la temporalité des épisodes d’une série, d’en disjoindre chacune des composantes, à l’image d’un échiquier, que Pascale reprend dans son texte à partir de la citation de Lewis Caroll. Une série serait alors à réinventer selon son traitement des temporalités mais aussi selon son traitement des lieux, et pourquoi pas des lieux de diffusion et des sources d’où émergent les images. Aujourd’hui, elles sont produites par la télévision, par le cinéma, par les vidéos, par les téléphones portables, par des drones, des professions entières génèrent même leurs propres images – notamment la police aux Etats-Unis, avec le FBI, la CIA, la NASA. Nous pouvons alors nous demander si les images produites par la NASA sont esthétisées ou pas, par exemple. Il est alors possible de jouer sur ces différents types de sources : pourquoi un épisode est-il à placer entre deux autres épisodes ? Pourquoi ne pourrait-on pas les redistribuer de manière aléatoire, par des grilles de lecture à recomposer, afin de générer des perceptions différentes ? Quant aux lieux de diffusion de ces ciné-tracts : le numérique, le web, les installations de type galerie… Puisqu’à travers cette idée de remise à plat du ciné-tract, il y a aussi celle de repenser les codes de production du cinéma – même si je préfère parler de films dans une position a-cinématographique pour reprendre le mot de Lyotard. Nous sommes déjà en train de quitter la salle de cinéma, à mon sens, mais il existe encore d’autres possibilités à explorer. Penser la production m’importe également : les ciné-tracts de Jean Luc Godard et Chris Marker étaient fabriqués dans une quasi-instantanéité puisqu’ils ne disposaient pas de pellicules et qu’ils pouvaient encore moins les développer. Ce sont ces effets de vitesse dans la fabrication pour exacerber leur circulation qui m’intéressent. C’est une réflexion sur le devenir politique de l’image.
Pascale CASSAGNAU : Toutes ces propositions, d’une manière ou d’une autre, convoquent le cinéma mais à la fois tendent à le dépasser, à le délier, le détourner, voire même à le contester. En même temps, puisque l’on vient d’évoquer le jeu d’échec, il me vient à l’esprit que peut-être ce n’est pas tellement la sortie hors du cinéma ou la mort du cinéma qui guette, mais simplement une nouvelle partie qui se propose, qui se jouerait après le cinéma, ou à côté du cinéma, ou avec le cinéma. Est-ce que chacun d’entre vous, avec vos projets respectifs et ceux que vous développez par ailleurs, vous avez le sentiment de jouer une nouvelle partie du rapport à l’image, plutôt que d’en affirmer la disparition ?
Mathieu PRADAT : Pour ma part, j’ai vraiment la sensation de participer à quelque chose de nouveau avec Proxima et la réalité virtuelle. Je continue pour autant à écrire et à tourner des films de cinéma, des courts-métrages, et j’espère continuer à le faire. La réalité virtuelle, et tous les médias et récits interactifs, ne me semblent pas s’opposer d’une manière ou d’une autre au cinéma mais proposer de nouvelles formes de narration. Cela permet aussi de « revoir » le cinéma : nous sommes habitués à ce dispositif. Dans les médias interactifs, on parle beaucoup de « faire une expérience », le mot devient d’ailleurs galvaudé, mais je pense que l’on oublie que le cinéma, justement, est une expérience. Les Frères Lumières ont inventé une expérience sociale qui aurait peut-être pu bénéficier d’un autre avenir si elle n’avait pas été inventée dans une France qui entretenait une certaine culture du théâtre et des habitudes sociales. C’est cette forme-là d’expérience sociale qu’est devenu le cinéma. Aujourd’hui, il est sans cesse concurrencé par la télévision, le web, mais pour autant, le plaisir d’aller dans la salle existe toujours, et je ne pense pas que ce plaisir soit en danger. En réalité virtuelle, je n’ai pas l’impression d’aller contre le cinéma mais de faire autre chose. Il y a évidemment des points de connexion très forts avec le cinéma mais comme il y en a avec d’autres domaines, notamment la littérature. Quand je développais Proxima, deux poèmes de Baudelaire étaient tout le temps présents à mon esprit : Le Gouffre et La Géante. Je pense que la réalité virtuelle est très proche des mondes intérieurs : on peut subjectivement se déplacer dans d’autres espaces et d’autres esprits. C’est donc autre chose que le cinéma, une nouvelle forme d’expression à part entière.
Valery GRANCHER : Je pense qu’il ne faut pas oublier que la réalité virtuelle existe maintenant depuis plus de vingt ans. Je me souviens des premières expériences dans les années quatre-vingt-dix : il s’agissait d’espaces assez définis. La question n’est donc pas neuve à mes yeux, elle est même plutôt désuète. Ce qui, au contraire, est assez nouveau, c’est que ce média est en phase de devenir un média de masse. Dans la structure du gaming, beaucoup de personnes achètent de nouveaux ordinateurs pour pouvoir regarder des films ou jouer en réalité virtuelle. Mon rapport à la réalité virtuelle ne s’établit donc pas en terme de nouveauté mais plus comme un questionnement sur le statut même d’une esthétique du virtuel. Lorsqu’on fait une peinture en réalité virtuelle, cela reste de la peinture mais le processus n’a plus grand chose à voir avec l’esthétique d’une peinture : c’est assez kitsch, assez flashy, et possède une grande capacité immersive. C’est cette nouvelle dimension qui pour moi est intéressante.
Nicolas MAIGRET : Pour ma part, je ne sais pas ce que je pourrais dire sur le cinéma car je pars d’une position plutôt extra-disciplinaire. Ce n’est pas forcément le lieu d’une investigation centrale dans mon travail mais plutôt un élément stratégique ou pertinent pour un propos donné. Globalement, sur le projet Pirate Cinema, le cinéma lui-même n’a pas une place centrale dans la mesure où c’est un média qui apparaît comme désuet à certains niveaux. Il s’agit plutôt d’une autre manière de donner la parole à des formes considérées comme pauvres en terme d’accès, de consultation, de dissémination. Lorsqu’on commence à creuser ces questions-là, on se rend compte que les médias se diffusent sur les plateformes pair-à-pair de manière extrêmement large et aux quatre coins de la planète. Cela présente plusieurs degrés d’intérêt : d’abord, cela permet un accès extrêmement important à des contenus très variés, mais cela a aussi un effet assez standardisant – les médias les plus distribués restant à peu près les mêmes que dans les espaces télévisuels ou cinématographiques mainstream. Pour autant, cela ouvre la voie à d’autres possibilités de diffusion, d’accès et de culture. Concernant la salle de cinéma, elle peut reprendre un intérêt comme espace de diffusion plus ou moins absurde ou tautologique pour mon projet, mais ce n’est pas forcément le cœur de ma réflexion.
Frank SMITH : Le jeu d’échec soulève plusieurs questions. En premier lieu, faut-il qu’il y ait des joueurs ? Est-ce que l’on est dans un jeu ? Est-ce qu’il y a un gagnant ? Est-ce qu’il s’agit d’une nouvelle partie ? J’ai la sensation qu’à toutes ces questions, nous pouvons répondre « non ». Je pense également que le futur proposé par les médias n’existe pas. Il n’y a pas de futur en ça. Peut-être que c’est à cet endroit-là qu’il y a un jeu : nous essayons de jouer avec ce qui se présente, tout en sachant qu’il n’y aura pas de futur.
--
Propos retranscrits par Pauline Quinonéro
Publié le 21/06/2017