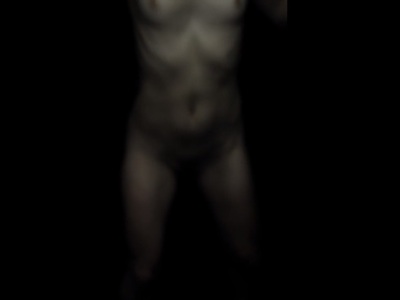Dans la continuité de White Epilepsy, dont il reprend en un sens le dispositif de réalisation en lui donnant une direction inédite, le film Meurtrière retrouve la question du monstrueux, qui devient ici une figure en dialogue avec des possibilités plastiques libérées par un geste pictural. Meurtrière en effet, par ses motifs et sa texture, tout en restant dans l'ordre qui est le sien — celui d'une recherche sur l'entrée en présence du corps au cinéma — fait songer tout à tour à Goya et à Bacon, parmi bien d'autres, dans la manière qu'il a de mettre en scène une forme de démembrement des corps en quelque sorte dévorés par la caméra. Cette dimension du cinéma comme dévoration était du reste annoncée à la fin de White Epilepsy, par l'apparition, à la fois violente et épiphanique, dans une lumière inattendue et tranchante, de ce visage de femme à la bouche sanglante.
Meurtrière s'ouvre sur un corps de femme, nu, d'abord offert dans une totale immobilité, et qui va bientôt disparaitre, mangé par l'obscurité. Rien n'est dit sur l'état de ce corps, mort ou vif, suspendu entre des possibilités multiples. La bande sonore, à la manière du travail engagé dans White Epilepsy, nous fait rentrer dans le ventre même du film, que nous semblons habiter de l'intérieur. Le cinéma, comme médium et comme lieu, travaille à une incorporation. Le film est à la fois la proie et le prédateur. Il fait corps, au sens immédiat de l'expression. Il ne peut approcher et restituer les figures qui sont les siennes sans les saisir et les avaler, sans reste aucun. Le film consomme son objet et se consume pour lui, dans un seul et même geste. Avec Meurtrière, nous sommes à la fois devant un corps et en lui, comme si le monde qui se dessine sous nos yeux avait perdu toute forme d'extériorité, ce que montrent parfaitement du reste les plans sur le ventre de la femme prise par de puissantes contractions.
La fragmentation du corps et sa disparition ont ici une nécessité et une force particulières, pour dire l'inquiétude comme matière première du cinéma. Le cadre et ce qu'il contient sont par instant indiscernables. C'est que le film, s'il a déjà trouvé son lieu propre, doit continuer de le chercher sans fin. Il est à la fois clos sur lui-même et ouvert sur un espace à nos yeux inaccessible et auquel il nous ouvre pourtant un accès. Une meurtrière en effet désigne, en même temps qu'une personne criminelle, une embrasure dans le mur d'une fortification d'où les archers peuvent scruter un ennemi qui vient. Cette ouverture invite moins à sortir qu'à nous maintenir dans notre forteresse intérieure. Le paradoxe ici, c'est que pour le cinéma, à la fois flèche et cible, toute visée est exposition, renversement, circulation immédiate entre le dedans et le dehors. Si monstres il y a, et donc quelque chose à montrer, il sont déjà passés à l'intérieur. "Nous ne considérons pas, écrit sainte Thérèse d'Avila, qu'il y a tout un monde intérieur au dedans de nous. Or, de même que nous ne pouvons pas arrêter le mouvement du ciel qui est emporté avec une rapidité prodigieuse, de même nous ne pouvons arrêter notre imagination" (Le château de l'âme, IV, 1). Pour la mystique, l'imagination est toujours inquiète, toujours à l'épreuve, toujours en danger, "dans les avenues du château, où elle souffre de se trouver au milieu de mille bêtes féroces". Meurtrière permet de redire à sa manière que l'imagination nous met en contact avec un monde mythique dont les premières images ne peuvent être accueillies que sur le mode de la rupture, qui a toujours quelque chose de radical et de violent, et que c'est à partir de ce fond là que ses opérations, et conséquemment, le cinéma lui-même qui les met en oeuvre, deviennent possibles. Notre vision voudrait elle chercher la paix qu'elle ne pourrait le faire qu'en s'aveuglant elle-même, ce que les mystiques du siècle d'or espagnol ont d'ailleurs particulièrement mis en lumière.
Ce qu'il y a d'inédit dans Meurtrière, par rapport à White Epilepsy et au cinéma de Philippe Grandrieux dans son ensemble, et qui fait ce film s'entretenir avec des figures considérables de la peinture, c'est un parti pris de montage qui nous emmène sur des terres inconues. La rupture d'un ordre logique ou naturel de la représentation, déjà assumée par la création sonore, est ici portée à la seconde puissance par de brusques changements d'intensités lumineuses et des superpositions qui sont une manière de dessiner un corps fantasmé à partir d'images elles-mêmes arrachées au noir. Ce n'est pas seulement l'obscurité alentour qui rend les corps indiscernables, c'est aussi les formes qu'ils proposent quand ils s'assemblent, se superposent les uns aux autres, se composent réciproquement pour esquisser les traits incompréhensibles d'une seule et unique figure meurtrière. C'est par le montage — des corps entre eux au tournage, puis des plans entre eux dans le film — que quelque chose de plus, nous ne savons pas bien quoi, ce qui est heureux, fait passer une extériorité à l'intérieur d'elle-même en en déchirant le voile. Philippe Grandrieux retrouve par ce chemin plastique, mais dans une langue tout autre, la violence qui traversait ses premiers longs métrages, et qui gagne ici une intensité nouvelle, celle d'un regard qui doit se poser sur ce qu'il ne connait pas, et se laisser guider par une main qui promet de le perdre, dans un acte de confiance dans l'inconnu qui, pour donner à la caméra d'accéder à la chose même vers quoi elle est tournée — cette manière d'éprouver le monde de manière convulsive que le film nous rend à sa toute fin, et qui est la façon la plus à même d'en comprendre la profondeur sans en trahir le secret — aura commencé par l'envoyer au plus loin d'elle.
Publié le 16/07/2015